


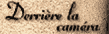




  
|
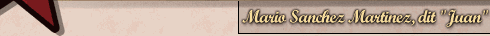 |
 |

Juan nous parla longuement de son travail dans le groupe Café Mezclado et des difficultés qu’il rencontre pour faire connaître sa musique. Les circuits musicaux sont multiples et croisés à Cuba. Tout est possible et permis, mais juste extrêmement difficile à mettre en œuvre.
D’une certaine manière, rap et reggae tiennent à la fois de la fascination et de la révolte. Ce qui est clair, c’est que leur positionnement est plus politique que social.
Juan manifeste une grande admiration pour Pepin Vaillant, il ne se situe donc pas en rupture avec les musiques cubaines.
Mais le rap cubain est différent des autres rap au moins pour quatre raisons.
Les rappeurs cubains connaissent le solfège et ils ont étudié la polyphonie. Ils ont été élèves des écoles de musique comme d’autres jeunes cubains profitant des structures héritées de la révolution. Leur rap n’est pas sophistiqué, mais il met en évidence cette culture et cette pratique musicale. Il est «travaillé», écrit.
En second lieu, le rap – et singulièrement le rap santiagüero et celui de Café Mezclado – joue abondamment sur l’improvisation qui est la caractéristique majeure de toute la musique populaire Guajira de l’Oriente. La qualité du rap cubain tient à ce talent, cette spontanéité et à une culture de l’invention poétique immédiate. En ce sens, il est souvent drôle, imagé et le rappeur santiagüero ne sera jamais perdu dans le contexte de la musique rurale, même si les vieux musiciens conservateurs vont avoir du mal à admettre l’intrus au sein de leur fête comme ce fut le cas à Yateras, quand Juan se mit à improviser une intervention rappée aux rythmes syncopés du changüi. «Ici, quand on veut entrer, on demande la permission», lui rétorque-t-on ! Et lui répond : «Mais le rap aussi vient de la montagne et des plantations de café !»
Troisièmement, le rap est une arme et, s’il se développe de cette façon à Cuba, c’est qu’il prend à contre-pied les idéologues de la propagande officielle. On adore la politique et la satire à Cuba. Par exemple, Juan répète dans le refrain d’une de ses chansons «Soy Cubano, soy popular», il cite exactement le slogan publicitaire de la marque de cigarettes la plus courante et bon marché à Cuba (les Popular que tout le monde fume). Mais, si le «popular» en question veut bien dire «peuple», «populaire» dans le sens de faire partie du peuple des travailleurs et d’être populaire auprès de lui : «Je suis cubain, je fais partie du peuple», dans l’argot de Santiago, chacun sait que le mot «popular» veut dire «être populaire», dans le sens «être apprécié» et notamment des touristes qui débarquent à Cuba pour vivre des aventures sexuelles et claquer leur argent avec des prostitués mâles ou femelles. Entendant Juan chanter, chacun a compris «Je suis cubain, je suis donc un gigolo, je suis une pute...» Là réside la caractéristique du rap cubain et son implication politique contournant ainsi la censure.
La quatrième chose qui retient l’attention, c’est la relative ignorance de l’actualité artistique et musicale dans le monde chez les rappeurs et en particulier chez les «branchés» de l’intérieur. Certes, ils savent ce qu’est le rap, mais ils sont, en général, totalement privés d’informations directes. Pas de disque, très peu de cassettes, la culture hip-hop ne semble pas avoir pénétré l’île de Cuba. Les gens ici font du rap ou du reggae, mais sans savoir au fond de quoi il s’agit. C’est évidemment le besoin d’une génération de se lier à l’air du temps et à des formes d’expression contemporaines et internationales, mais dans une sorte de fascination pour l’interdit occidental et américain. 
|
 |
|
|
|
|
|






